Benoît Caudoux, né en 1974, est professeur de philosophie à Lille. « La Migration des gnous » est son premier roman.
 © Dominique Houyet
© Dominique Houyet
Peut-on résumer « la Migration des gnous » ? Que raconte cette histoire ?
L’histoire, s’il y en a une, ne se résume pas. C’est celle d’un gnou qui essaie de dire sa vie erratique de gnou avec ses compagnons de voyage et qui dit un peu aussi le langage : « Si nous savions seulement trouver l’humilité de reprendre ces cris d’abord insignifiants, de répéter ces lois orales mystérieuses, de perpétrer l’écho de tous ces acousmates jusqu’à ce qu’ils prennent sens et deviennent un langage riche et expressif, foisonnant et profond, nous saurions pour de bon ce qu’était notre espèce et quelle était sa route, son lieu et son destin, notre but, notre histoire elle-même jusqu’à son dénouement : nous aurions été gnous, quelle que soit l’issue. »
Ces gnous sont fiers, ils courent à travers l’Afrique, vers le Nord, et pourtant il règne donc une certaine humilité dans ce troupeau de gnous qui n’est rien tant que rien n’est dit. Et même quand ils existent, quand ils sont dits par ce gnou narrateur, un mystère demeure : car ce troupeau est constitué malgré tout de gnous différents et individuels, des gnous vigoureux, maladifs, rapides, lents, forts, dominés, mais comment l’exprimer ?
« La Migration des gnous » est cette hésitation perpétuelle entre le particulier (ce gnou narrateur, est-il porte-parole, est-il le troupeau, exprime-t-il seulement sa particularité au sein du troupeau ?) et le troupeau qui se définit difficilement car collage immense de particules-liées. Cette course, c’est peut-être la recherche du juste milieu, de la balance et la recherche de l’unité entre les mots et l’objet et alors les gnous deviennent métaphore : la transhumance est perpétuelle, il y a toujours un ailleurs vers lequel courir, et le but est toujours poursuivi. Ce morcellement en dit long aussi : le livre est un assemblage délicat de paragraphes glanés ici et là ; le « troupeau de paragraphes » forme un livre ; lus individuellement, ils sont tous liés, sont tous différents, ce sont presque des poèmes en prose. L’écriture témoigne d’une recherche minutieuse du mot exact, mais aussi d’une grande soumission face aux mots qu’on ne maîtrise pas vraiment et qui peuvent absolument tout.
Vous avez publié « La migration des gnous » en 2004, pouvez-vous résumer ce livre ?
Il est assez bien résumé dans le titre, je crois : il s’agit d’une migration de gnous, et même de la migration des gnous, puisque les gnous migrent tous ensemble, annuellement, pour suivre l’herbe qui pousse là où la pluie le veut bien. Ils sont suivis par une foule d’autres animaux, d’ailleurs, c’est une chose amusante. Ce qui m’a plu, c’est ce mouvement, cette course folle, entêtée, répétitive, qui incarne quelque chose du rapport de la conscience à l’espace, au sol. C’est-à-dire qu’il y a là quelque chose qui donne à penser la présence, et c’est ce qui m’intéresse. Et puis, les images, bien sûr, les sensations mais aussi l’imagination, car quand j’ai écrit ce livre je n’avais jamais mis un pied en Afrique : c’était pour moi le continent imaginaire par excellence, et je crois que ça l’est plus encore pour ceux qui y sont , bizarrement ; plein de gens m’ont dit que c’était vraiment ça, la façon dont je parlais des paysages, des terres… C’est aussi une chose très riche à développer, le rapport de l’Occident à l’Afrique. Et puis, bien sûr, la « Migration des gnous », c’était pour moi une « histoire » très belle, d’abord parce qu’elle n’a pas de sens : les gnous tournent en rond, mais ils tournent en rond avec acharnement, avec la mort aux trousses…
Mais pourquoi des animaux, et pourquoi des gnous ?
Je crois que l’animal permet de reprendre les choses « à zéro ». Il est là, c’est tout. Et le gnou est un animal un peu étrange, presque monstrueux, ce qui le réduit encore plus à lui-même, à sa situation. Je les trouve drôles et touchants. Les hommes civilisés,eux, ont l’obsession du sens, de la finalité, du but ; ils veulent l’Histoire, la ligne droite, avec un passé et un futur. A un moment, mes gnous quittent le cercle de leurs migrations annuelles, et filent tout droit vers le nord : ça aussi, c’est un thème qui me tient à coeur, ce mouvement de la tangente. Comment trouve-t-on quelque chose ? On tourne, on tourne, et puis d’un coup, on entrevoit quelque chose, un sens possible justement. L’histoire, les histoires se jouent sans doute là, dans ce passage du cercle à la demi-droite. C’est l’invention du sens, que font mes gnous confusément.
Et ce sens reste confus ?
Je compare beaucoup l’écriture aux arts plastiques dont je me sens proche dans ma façon de faire : dans les arts plastiques, on comprend mieux que rien ne sort de rien. Il faut de la matière, du chaos, quelque chose de non voulu, de non choisi, de non pensé, dans laquelle on entrevoit seulement, à un moment, la possibilité d’une forme. Bacon commence par faire une tache sur la toile. C’est comme quand on griffonne n’importe quoi sur un bout de papier en téléphonant, et qu’au bout d’un moment on finit par en tirer le dessin d’une maison, d’un visage, en bricolant un peu, en effaçant, en reprenant, en ajoutant. Il s’agit de voir la forme possible dans la matière donnée, comme un sculpteur. Je n’aime pas l’idée de projet, qui me paraît toujours vaine. Il y a des livres où l’on voit que l’auteur a eu une idée, qu’il s’est dit « tiens, je vais faire un livre là-dessus, qui commencera là et finira là… ». Alors il l’écrit. C’est de l’intelligence, selon la définition la plus courante. Ça ne m’intéresse pas beaucoup.
Qu’est-ce qui vous intèresse alors dans l’écriture ?
J’aime la recherche, les gens qui creusent, qui grattent, qui sculptent. Ceux qui ne comprennent pas. Là, il y a de la place pour la vérité, pour la sincérité. C’est comme dans la vie ensemble : il y a des gens qui sont toujours « intelligents », qui ne sortent jamais de ce qu’ils croient maîtriser, savoir. Ils sont bien installés en eux-mêmes, et ne parlent que pour dire quelque chose (soi disant). Et puis, il y a être ensemble dans son ignorance, dans sa nudité, dans sa bêtise. Dans sa présence, dans sa singularité. La singularité est fatalement idiote. Ça n’empêche pas de parler. On peut toucher du doigt, parfois, l’autre, et soi-même. Ce n’est plus de l’intelligence. C’est de la poésie, de l’amour, de l’amitié. Ou bien de l’illusion… Les bêtes, c’est un modèle de présence… être bête, ça peut vouloir dire ça. Dire des bêtises, parfois, ça permet de se toucher. Alors que dire des choses qu’on a apprises, ma foi… parler de soi… c’est souvent empêcher les autres de vous voir, et se perdre. Donc ça oblige à se poser la question de comment parler. Comment sortir de toutes les rhétoriques qu’on entend blablater dans sa propre bouche, le plus souvent ? Comment être avec l’autre, avec soi-même ? Comment être fidèle ? A quoi ? Tout ça, ce sont des généralités sur l’écriture, au sens intransitif du terme : celui où on n’écrit pas quelque chose, mais où on essaie d’écrire, tout court, comme on peut vouloir parler tout court.
Et pour ce livre en particulier ?
Mais justement, la « Migration des gnous », ça a été pour moi un moyen de ne parler de rien, tout en ayant un prétexte, et même une histoire, une singularité parfaite, absurde, aberrante, ridicule tant elle est singulière… « ça ne s’invente pas » : donc ça existe. Et du même coup, l’ensemble des thèmes que j’ai pu entrecroiser, développer en écrivant ça.
Où puisez-vous votre inspiration ?
Je n’ai jamais eu l’idée d’écrire la « Migration des gnous ». J’écris, dans des carnets, des tas de petites choses, et un jour j’ai écrit quelque chose comme la première phrase du livre. C’était une image qui me plaisait, le troupeau, le mouvement. C’était propice à l’écriture. Quelque chose qui noircit un fond, qui avance, on ne sait pas où ça va, mais on y va. Et puis, comme ça marchait bien, j’ai continué, j’ai pris un autre carnet dédié aux gnous, et en écrivant là-dessus, j’ai réalisé peu à peu que je pouvais dire des tas de choses. Des choses que j’avais en moi depuis longtemps, qui cherchaient leur nom, et des choses dont je n’avais pas idée. C’est ça, être bête… au sens où je le disais tout à l’heure : c’est en parlant, en arrivant à parler un peu plus « vraiment » que d’habitude, que parfois, on apprend ce qu’on pense. Inversement, les choses qu’on croit avoir apprises nous empêchent de parler, de comprendre, y compris ce qu’on apprend, trop souvent.
Pourtant vous êtes professeur de philo…
Je suis un peu fâché avec le scolaire, depuis longtemps, pour ce genre de raisons. Mais je dois dire que cette histoire de demander à l’autre ce qu’on pense, d’essayer de le comprendre en se rendant capable de parler le plus justement possible (et pour ça il faut bien la langue et une part de rhétorique, en tout cas dans l’apprentissage) – cette histoire de parler pour savoir ce qu’on pense, c’est aussi ce que j’essaie d’enseigner, en tant que prof de Philo. C’est-à-dire que j’essaie d’être prof de confiance : pour lire ou pour écrire, expliquer des textes ou faire des dissertations, il faut cette confiance qui permet de parler à quelqu’un, et même à tous (de parler publiquement, d’écrire…) comme pour soi-même , ce qui n’est déjà pas simple avec soi-même… Et c’est la même chose pour lire : il faut savoir faire crédit, c’est une lourde affaire de confiance, tout ça. L’expérience de l’enseignement de la philosophie, en ce domaine, m’a beaucoup apporté, je crois. Ce qui vous saute aux yeux, dans une classe, c’est la méfiance envers l’écrit, envers les autorités, les auteurs.
Vous avez l’impression que les élèves appréhendent les auteurs avec suspicion ?
C’est peut-être surtout vrai aujourd’hui, avec des élèves pour qui le texte, c’est d’abord la publicité, la communication, et la rhétorique scolaire : autant de contraires de la parole… Devant un texte, ils commencent souvent par écrire : « Dans ce texte, ils essayent de nous convaincre que… ». C’est comme ça que mes élèves lisent les textes, au début du moins. C’est au prof d’essayer de montrer (et prouver!) qu’on peut parler sans intérêt, sans être intéressé, s’adresser aux autres en même temps qu’à soi-même, ne rien avoir à vendre, ne pas vouloir convaincre, mais simplement chercher. Parfois ils ont raison, tout n’est pas sincérité dans les textes. Mais si on commence par la méfiance, on passe à côté de l’essentiel, je crois. C’est ce que j’expérimente, surtout dans les classes les moins « bonnes ». On voit dans les contradictions de l’école, ce que peut être la culture, ce qu’elle est. On le voit en termes d’ouverture et de repli, de confiance et de méfiance, de guerres d’identités. On voit le mal que font les prétendus goûts que chacun s’empresse d’avoir, pour bien se tenir en main. Tous les murs qu’on élève. Et le plus grand paradoxe de la culture, c’est celui de l’école, qui la retourne contre elle-même, en en faisant l’outil numéro un de la distinction. Heureusement, cette école là n’existe plus que dans l’esprit des profs : l’argent se passe de mieux en mieux de masques, et peut-être bientôt l’école sera-t-elle vraiment le lieu de la culture, de l’ouverture, de la compréhension. Si elle existe encore, et si elle intéresse encore quelqu’un.
Comment se déroule l’écriture d’un tel livre ? Combien de temps vous a-t-il fallu ?
Une fois que j’ai eu pris un carnet « spécial gnous », j’ai peu à peu pris le pli : tout ce qui me venait (voilà l’inspiration… elle est en retard de quelques questions) – des choses viennent, en parlant, en écoutant, en lisant, en regardant, en rêvant, je ne sais pas : des choses viennent qui « sonnent » d’une certaine façon, dont je sais qu’elles relèvent de l’écriture. Elles ont un rythme, une couleur, quelque chose qui fait qu’elles ne sont pas à dire ou à penser mais à écrire. Ce sont des notes, des phrases, ou même moins que ça. Bref, au bout d’un moment, je crois que tout ce que j’aurais écrit de différentes façons dans mes carnets, avant, me venait sous forme de gnous. Il y a eu une équation : écriture égal gnous, gnous égal écriture. J’écrivais de la même façon mais tout était gnou, et en retour, ce qui était formidable, c’est que d’avoir une histoire de gnous qui prenait forme peu à peu en s’incorporant tout, m’a permis aussi d’écrire des choses que je n’aurais pas trouvées autrement. C’est ce que je disais tout à l’heure : le miracle du prétexte, de la matière, qui appelle littéralement les formes. On peut comparer ça, pour le bien que ça fait, à la psychanalyse, sans doute, bien que ce soit différent : l’histoire est un prétexte (je ne vous fais pas l’affront de l’écrire avec un tiret) qui permet de laisser sortir des choses qu’on découvre importantes, qu’on est content de trouver en soi, et qui servent, quelquefois. C’est comme un rôle pour un acteur. Bref, je n’écrivais plus que des choses qui avaient forme de gnous, et même des choses dont je ne voyais pas le rapport avec le livre, j’y mettais du gnou quand même, malgré moi. D’ailleurs je crois qu’au final tout a trouvé a place dans le récit, sauf bien sûr plein de choses nulles, supprimées. Donc, le livre, c’est une période de mon écriture où j’ai trouvé par un petit miracle une forme, une unité propice au genre de sensations, de thèmes qui me préoccupent, ou qui m’habitent. Je crois qu’il n’y a pas de livre sans ça, ce petit miracle temporaire d’unification de soi, de ses mots. Comme quelqu’un qui raconte une histoire qui lui va bien… : il peut y mettre beaucoup de choses. Dans les gnous c’était évident, en plus, parce que c’est gros, cette histoire de gnous, quand même… Non?
Et comment passe-t-on d’un « prétexte » à un autre, si chacun devient tout?
Après la « Migration des gnous », j’ai eu peur (sérieusement!) de ne plus pouvoir m’arrêter d’écrire des histoires de gnous : je continuais à tout dire dans cette langue (c’est prétentieux mais on pourrait dire que cette unité dont je parle, c’est comme une langue…). Mais ce n’est pas toujours aussi marqué : parfois l’unité d’un livre est plus ténue, mystérieuse, mais elle est là quand même. C’est ce que j’ai recherché dans Géographie , mon deuxième livre : peut-être parce que je sortais d’un livre au prétexte marqué, un peu fou, je crois que j’ai voulu chercher l’autre limite, l’autre extrême de ce qui fait « un livre ». Dans certains cas, cela finit par n’être plus rien d’autre que la figure, le visage de l’auteur, qui arrive à ne plus faire de grimaces, à ne plus rien jouer. A se passer de prétexte… Mais alors il en est un lui-même : sa présence. Il faut avoir renoncé à tout, et dans ce cas la littérature rejoint la Philosophie, je crois. Tout en étant vraiment littérature. Autant dire que la littérature l’emporte, à mon sens, parce qu’elle implique encore plus de renoncement : elle renonce même à dire quelque chose. C’est une autre littérature, celle de la nudité. Il y a la nudité et le costume, dans l’écriture, et bien sûr il ne faut pas trop les opposer, ça va ensemble, ô combien. Mais ce sont deux pôles. Dans mes lectures j’ai des modèles de nudité, comme Perros, et des modèles de masque, comme Chevillard. Pardon à eux, je leur fais violence en disant ça, mais c’est ce qu’ils sont devenus pour moi. Je suis mû par la tension qu’il y a entre ces deux pôles, le nu et le masque.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé à devenir écrivain ?
Je parlais du renoncement et des rapports de l’écriture à la Philosophie… Je crois que mon « parcours », si j’en ai un, est celui-là. C’est une soustraction : j’ai choisi la Philosophie parce que je ne voulais rien faire, je ne voulais pas construire mais me consacrer au sol, l’explorer : le trouver, déjà… trouver un sol solide. Bon, j’étais jeune… Je trouvais prétentieux et risqué de s’empresser de bâtir des tours sans même s’intéresser au sol, à l’en dessous… Pour moi, la Philosophie, ça a été ce renoncement à la construction, cette recherche du sol, du vrai. Qu’est-ce qu’on peut dire ? Et tout naturellement, avec cette démarche là, j’ai fini par choisir plutôt l’écriture, où l’on renonce encore à un peu plus de construction… Comment parler ? On ne cherche même plus de discours vrai, dans l’écriture, on cherche sa voix, ou une voix, ou à comprendre ce que c’est qu’une voix, un narrateur. C’est encore en dessous… C’est le même mouvement, pour moi.Celui du renoncement à certaines évidences des autres, qui me paraissent suspectes.
Vous avez une écriture très poétique, pourriez-vous expliquer pourquoi ?
J’ai un peu de mal avec la notion de genre, qui est une notion scolaire avant tout, je crois. Disons qu’il ne faut pas trop s’en préoccuper au moment où on écrit. C’est un outil de lecteur, de critique… ou d’éditeur. La Poésie, ça existe, on pourrait en parler… mais de là à « faire de la poésie »… J’ai plutôt tendance à en faire un tabou : si la poésie est atteinte ici ou là, tant mieux. C’est un des effets de l’écriture, et une de ses causes. Normal qu’elle la traverse. En fait, la question que je me pose, c’est celle du livre. Comment faire un livre ? Quel livre ? ça recoupe ce que je disais tout à l’heure sur l’unité d’un livre. Cette unité doit pouvoir réunir différents « genres ». C’est ce que j’ai essayé avec Géographie. La question principale est celle de l’histoire, encore une fois. Quand y a-t-il une histoire ? C’est-à-dire : faut-il que quelqu’un prenne la posture de celui qui en raconte une, pour qu’il y ait histoire ? Je ne crois pas. Je crois qu’il y a toujours histoire, de différentes façons, dans la conscience du lecteur. Rimbaud peut avoir la forme d’une histoire. Il en a une et il en est une. Il y a histoire parce qu’il y a travail, recherche, comme je le disais. On ne parle pas comme ça, immédiatement : « j’aime ceci, je pense que… ». Il faut aller chercher la parole, la voix, la poursuivre et la creuser, et cela, c’est une histoire. Je crois que c’est Blanchot, qui dit ça : qu’il y a un récit de la venue à la parole, et que c’est même le récit par excellence. Le récit « poétique » en tout cas. Pour la « Migration des gnous », il s’agit vraiment de ça : mon gnou raconte comment il est arrivé à raconter, à être une conscience, à devenir une voix, à être traversé par des impressions qui deviennent expressions, et s’unifient singulièrement, sans qu’il y ait forcément intelligence, compréhension, science. Sans qu’il y ait forcément quelque chose à dire.
Vous souhaitez quand même faire passer un message, avec ce livre, ou vous privilégiez exclusivement l’écriture elle-même ?
Le message, ce n’est pas trop mon truc. Mais je pense quand même une ou deux choses, que j’ai besoin de partager, ne serait-ce que pour les vérifier ou tout simplement pour « toucher » mon semblable, le rencontrer. Je gratte aux portes… Les chats n’ont pas besoin d’avoir un message pour gratter aux portes… sinon, ça s’appelle des commerçants… Mais les chats nous donnent à penser, à comprendre, en venant, en repartant. Peut-être que dans cette expression d’avoir un message, c’est le « avoir », aussi, qui me gêne. Ca évoque quelque chose d’unilatéral. Je ne vois pas comment celui qui ne chercherait rien pour lui-même aurait quelque chose à nous dire. Alors je préfère parler de rencontres… Les messages, je laisse ça à ceux qui font de la communication, c’est-à-dire le contraire. Eux, ils ont un message. Et on voit ce que ça entraîne : de la séparation. Un message, c’est adressé, on sait à qui on veut le « faire passer ». On a un message pour les 13-15ans des classes moyennes, par exemple… c’est l’extrême opposé de ce que j’évoquais tout à l’heure : la présence. J’essaie d’écrire en tant que je suis là, que j’ai des perceptions, des affects. D’où l’animalité, qui se réduit à peu près à cette présence, cet universel. Les 13-15ans des classes moyennes des grandes villes en France au milieu des années 2000, c’est l’autre bout de la lorgnette. Mais il y a aussi des livres qui ont ce genre de cibles. C’est autre chose. Alors pour faire une pirouette, je dirais volontiers que si j’ai un message, ce serait volontiers qu’on peut exister sans, et qu’on est certainement plus fidèle à ce qu’on est, quand on n’embête pas la terre entière avec ses petites opinions. Evidemment, on peut moins facilement dire « qui on est », ensuite, et se situer les uns par rapport aux autres dans la grande guerre des clans de l’identification et de la distinction. Mais vous voyez, ça, ce n’est pas « mon message » (au mieux, ce serait plutôt celui de Bourdieu) : mais c’est quelque chose que chacun doit obligatoirement retrouver pour lui-même, par lui-même, ou rater. Ce « message » là, je l’oublie, je ne le possède pas, ce n’est pas une opinion, je ne l’ai pas à l’esprit comme projet quand j’écris, mais il me hante sans doute, et j’espère – j’espère – qu’il transpire un peu dans mon écriture, malgré moi. Il y a beaucoup de « malgré moi », dans mon écriture… Ce sont des « malgré moi » que je cherche pour moi…
Allez-vous écrire un autre roman ?
J’ai fini un deuxième livre, dont je parlais tout à l’heure, Géographie, qui doit sortir en janvier chez Léo Scheer, et qui relève de cet effort d’unité de soi, malgré soi, justement. Une autre identité, une autre unité que celle du récit de soi, de la posture, du « message ». Une unité qui ne soit pas postulée mais laissée, espérée. J’irais bien jusqu’à dire que c’est le livre qui fait l’auteur : l’auteur est le projet du livre, pas l’inverse. Je vous jure que ce n’est pas du tout qu’une fantaisie… même si ça en prend la tournure assez souvent! C’est l’unité du visage de l’auteur dont je parlais, avec quelques grimaces quand même, et une petite collection de masques, mais des masques grossiers… faits maison. J’ai aussi un autre petit livre, plus narratif, celui-ci, c’est plutôt une nouvelle, que je devrais publier bientôt, en tout petit format, de façon artisanale, en typographie, chez un « micro-éditeur » qui fait de très beaux livres, les éditions Brandes. Je tiens beaucoup à ce projet aussi… j’ai envie d’aller dans l’atelier, toucher le papier, les presses… d’autant que c’est un petit texte où je disparais complètement – alors je peux faire comme s’il était d’un autre. Et puis, j’ai encore deux livres en chantier, dont je ne sais pas s’ils aboutiront, mais je les porte, et je travaille à l’un d’eux, plutôt léger, Sur Quatorze façons d’aller dans le même café. Ce ne sera peut-être pas un livre, mais je m’amuse à l’écrire et, là aussi, je trouve de quoi parler, une forme, une unité. Alors je le fais pour ça, pour moi, pour les amis… Voilà. Et puis, j’ai dans un tiroir des carnets rapportés d’un voyage en Pologne avec un ami, écrivain et comédien d’origine polonaise qui voulait faire une espèce de voyage symbolique dans ce pays par lequel il est marqué sans le connaître. Et bizarrement, c’est moi qui ai écrit, et pas lui, là-bas… ça, je voudrais bien en faire une sorte de récit autobiographique, léger – même s’il y a un vrai fond de sérieux dans cette histoire, encore une fois, d’identité, et de liens.

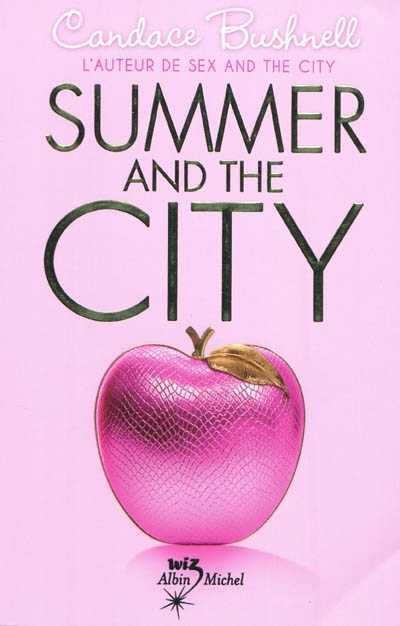

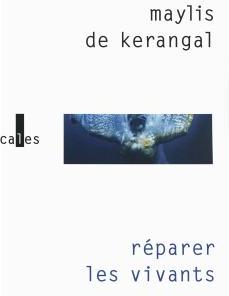
No Comments